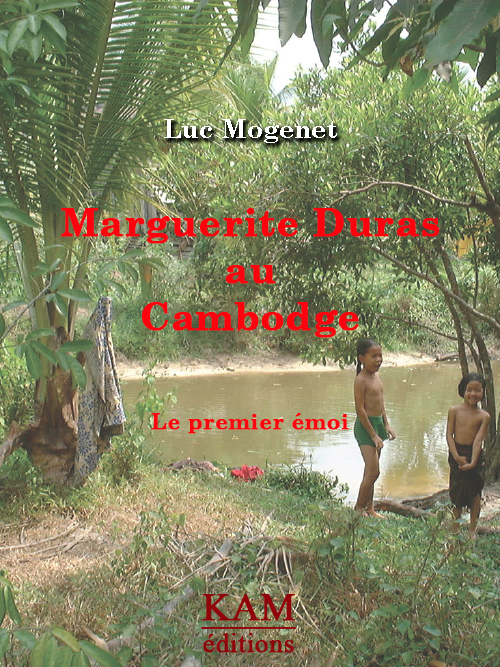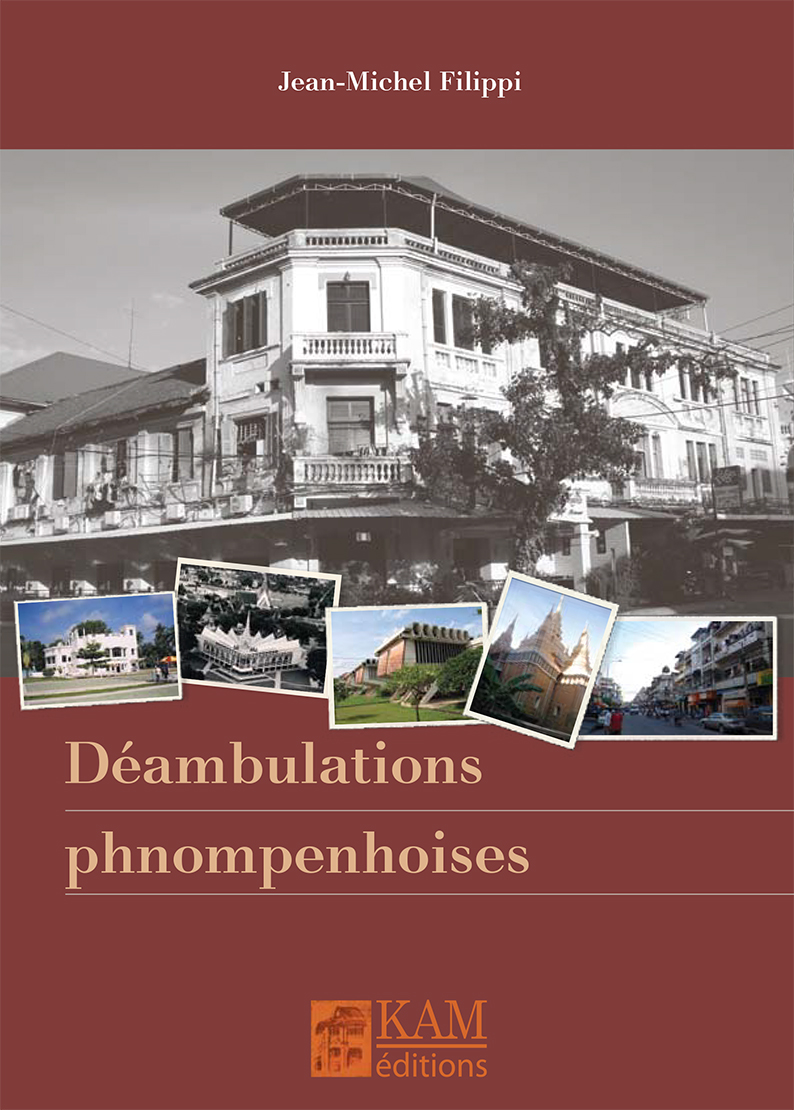Le petit monde de Sim le chauffeur
Parue en 1956, la nouvelle de Im Thok, Sim Le chauffeur, détonne véritablement au sein d’une production littéraire marquée par une exclusion du social.
L’auteur est peu connu. Il exerça le métier de journaliste dans les années 50 et entre 1956 et 1958 écrivit trois petits romans abusivement qualifiés de « nouvelles ». A l’instar de beaucoup d’ouvrages à tirage limité paru dans les années 50, ces textes auraient probablement disparu dans la tourmente qui a suivi les années du Sangkum Reastr Niyum (1955-1970) s’ils n’avaient été redécouverts pendant la République Populaire du Kampuchéa (1979 - 1992) et réédités comme manuels scolaires.
Didactisme, politique et éducation
L’ouvrage nous relate les conditions de vie d’un sous prolétariat issu d’une campagne qui ne peut plus le nourrir et qui cherche à Phnom Penh les moyens de sa subsistance. Im Thok décrit essentiellement un milieu de coolies pris dans le piège d’une précarité extrême.
Sim est le personnage pivot de l’ouvrage en ce qu’il a des amis coolies auxquels il offre conseils et rudiments d’éducation. Il exerce la profession de chauffeur, ce qui lui permet d’être en contact avec d’autres couches de la société.
Sim utilise le peu d’argent qu’il gagne pour acquérir journaux et livres. Il s’en explique à son ami San : « Je ne veux être instruit que pour trouver le chemin de la justice et c’est tout. Je veux être instruit pour défendre ma liberté et mes droits et ne laisser personne m’en priver. Je veux être instruit, pour contribuer à affermir et renforcer la neutralité, l’indépendance et la démocratie dans notre pays... ».
D’aussi belles intentions ne sont pas pour éviter l’écueil du didactisme quand Sim entreprend, à la demande de son ami Meng, d’éduquer les coolies sur la politique internationale ou les conditions de vie des travailleurs dans d’autres pays. A la question « Est-ce qu’on y achète aussi les gens pour les exploiter comme nous à longueur d’année ? », Sim répond par un éloge appuyé du monde socialiste : «...dans ces pays le progrès économique est rapide. Les ouvriers, les coolies sont maintenant propriétaires de leur travail ». A ce paradis sur terre s’oppose « le bloc impérialiste » où « Ceux qui ont à manger et ne manquent de rien obtiennent encore plus, les pauvres deviennent de plus en plus pauvres».
La solution aux yeux de Sim passe par le tissage de liens de solidarité « il est absolument nécessaire que nous réunissions nos forces et que nous formions des associations ». Eduquer est le maître mot, ce qui n’est pas pour nous surprendre dans le contexte des années 50 et 60 où l’éducation était vue, et pas seulement au Cambodge, comme le correctif de toutes les disharmonies sociales. Ainsi, à tante Prem qui s’enquiert de ce qu’il faut faire, Sim répond « Solidarisons-nous intimement pour étudier... ».
Le Sangkum Reastr Niyum (SRN) dans le prisme de Sim le chauffeur
Ce petit roman est une mine d’information sur la perception qu’ont les milieux progressistes cambodgiens du SRN.
Nous sommes en 1956, un peu plus d’an après les accords de Genève qui ont consacré la neutralité du Cambodge, l’abdication du roi Norodom Sihanouk en faveur de son père pour pouvoir gouverner et, bien sûr, la création du SRN qui va dominer la scène politique cambodgienne jusqu’en 1970. Le SRN (communautés socialistes populaires) n’est ni une théorie ni un parti politique, mais a été et restera dans l’esprit de son concepteur un mouvement de masse, véritable creuset destiné à opérer de vastes rassemblements pour affirmer et défendre les intérêts de la nation cambodgienne. D’où le recours à des procédés de démocratie directe, diversement appréciés, où, à l’occasion de longues messes, le peuple se voyait accorder la possibilité d’interpeller ses dirigeants.
La gauche cambodgienne acceptera de jouer le jeu et des membres de sa fraction marxiste occuperont à diverses reprises des fonctions gouvernementales, comme Hou Youn et Khieu Samphan.
Un thème important du roman est la neutralité du Cambodge. Sim ne manque pas de faire à son collègue San un cours sur ce qui menace la neutralité cambodgienne : « La S.E.A.T.O. (l’acronyme Français en est OTASE : Organisation du Traité de l’Asie su Sud Est, créée le 8 septembre 1954) exerce une main de fer sur la Thaïlande et les Philippines très proches de nous...des hommes politiques indépendants de grand renom...l’accusent d’être un groupe belliciste, destiné à casser les accords de Genève qui ont amené la paix en Indochine ». Le thème est des plus mobilisateurs et Sim trouve des accents vibrants pour l’exprimer : « Nous devons faire serment d’extrême solidarité et d’amour pour notre gouvernement, pour notre assemblée, afin qu’ils défendent sérieusement notre souveraineté ».
En matière de liberté d’expression les limites semblent encore très floues. A son collègue San qui évoque les dangers de la lecture de journaux de gauche comme « la nation » ou « Le peuple ». Sim rétorque : « je n’ai encore jamais vu personne qui m’ait interdit quoi que ce soit, sauf toi qui cherche à m’effrayer...le gens comme toi San [] sont les vrais destructeurs de la liberté et des droits du peuple khmer ».
Une description réaliste
Au coeur du roman, la vie quotidienne des coolies est minutieusement décrite. Il s’agit de la couche la plus misérable de la société cambodgienne : « nous devons supporter les tâches les plus lourdes, nous ne sommes pas différents du béton qui constitue l’armature d’habitations... ». La spirale de la misère est particulièrement bien décrite et, à peine les salaires sont-ils distribués qu’ils servent déjà à rembourser les dettes contractées auprès des marchands de vermicelles et de glaces. A l’impossibilité d’accumuler le minimum qui permettrait d’alléger la misère s’ajoute l’angoisse devant les difficultés de trouver un nouveau travail une fois le chantier achevé.
Le milieu des coolies n’est pas le seul dépeint et nous faisons aussi connaissance avec le milieu des employeurs de Sim. Le jour et la nuit serait presque un euphémisme pour rendre compte des différences entre les deux couches sociales : voiture avec chauffeur, enfants à l’école française, épouses au foyer, maîtresses, nombreuses distractions... L’éducation que Sim a acquise en autodidacte lui permet de donner la réplique à son patron et leur conversation de mettre ainsi en valeur la distance immense entre les deux types d’existence. Ainsi, prenant prétexte d’un concours de beauté, Sim cite à son patron l’opinion d’une certaine Prem sur les conditions « des millions de femmes...qui s’échinent à construire des routes [] on ferait bien mieux de leur donner un salaire décent pour vivre ». Son patron a beau jeu d’invoquer une fatalité, soi disant caractéristique de la culture khmère, dont on use et abuse pour légitimer des positions sociales : « Ses malheurs ne sont-ils pas le fruit de ses actes passés ? ». Ce à quoi Sim rétorque : « Mon épouse dit que ce n’est pas vrai du tout que cela soit le fruit du Karma. Depuis qu’elle peut lire les journaux, elle pense que nos malheurs à nous les khmers viennent du colonialisme qui nous a opprimés ».
L’intérêt de cette répartie n’est pas tant dans l’opposition entre causalité naturelle et causalité sociale. Bien au delà, elle nous enseigne qu’il ne saurait y avoir une culture khmère statique censée exister de toute éternité ; il n’y a pas d’exception culturelle cambodgienne et ce que l’on entend par culture, ici comme ailleurs, a préalablement été informé par le crible du social.
Jean-Michel Filippi